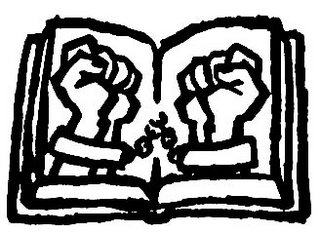L’élection de mi-mandat aux États-Unis a fait naître chez bon nombre d’observateurs de gauche et anti-impérialistes une certaine espérance. Celle-ci s’est concrétisée avec la démission dès le lendemain de l’acteur le plus symbolique de la politique étrangère impérialiste de l’administration Bush, l’inflexible ministre de la défense, Donald Rumsfeld. La victoire permettant au Parti démocrate de contrôler les deux chambres du congrès américain permet également de rêver à l’amoindrissement du pouvoir présidentiel de George W. Bush. Le pouvoir de la Chambre des représentants sur le budget, et celui du Sénat sur les diverses nominations, seront des obstacles de taille pour Bush et son équipe. Le président américain n’ayant plus la capacité de mener à bien les politiques extrémistes de son cabinet, tant en politique étrangère qu’en politique intérieure et en gouvernance, il est à croire qu’il se tiendra tranquille pour le reste de son mandat.
Pourtant, avant de se féliciter d’un quelconque virage à gauche de la société américaine, il faut prendre conscience des significations les plus tangibles de l’élection du 7 novembre dernier. Comment peut-on aborder la vie politique américaine, là où rien ne se passe comme ailleurs, avec ses élections réglées par la constitution, son bipartisme institutionnalisé depuis des générations, où en une soirée l’électeur doit se prononcer non seulement sur le mandat de plusieurs personnes, mais aussi sur des questions litigieuses amenées par référendum? Il est donc intéressant d’évaluer les espoirs, mais surtout les réserves, envers le retour en force des élus démocrates au pouvoir.
La fin du néo-conservatisme?
La défaite électorale des républicains est d’abord et avant tout attribuée à l’enlisement des troupes américaines en Irak. Il ne fait aucun doute, la majorité des électeurs, surtout les démocrates mais aussi les électeurs indépendants (non-affiliés avec les deux principaux partis) ont été motivé de voter contre Bush sur la question irakienne. Avec un bilan calamiteux en morts de toutes parts, de même que l’absence d’amélioration aux plans politique et social sur le terrain, la hausse vertigineuse des dépenses, une série de scandales (les actes de torture, les pratiques insensées menées par les militaires américains à la prison d’Abu Ghraib), l’absence de preuve sur la possession par l’Irak d’armes de destruction massive, le bilan était trop lourd à soutenir. Bon nombre d’électeurs républicains ont aussi contribué à sanctionner l’administration Bush, en votant contre ses représentants ou en s’abstenant de voter.
Une fois la punition infligée et le responsable désigné, Rumsfeld, « démissionné » de ses fonctions, comment le président Bush et sa garde rapprochée vont-ils désormais mener leur politique? Au mieux, pour les progressistes de tous les pays, ils vont devoir diriger avec la menace annoncée de devoir rendre des comptes dans les deux prochaines années, par le biais des commissions du Sénat et de la Chambre. Plusieurs élus démocrates et des républicains modérés souhaitent faire la lumière sur les circonstances entourant le déclenchement de la guerre en Irak. Mais on ne devrait pas nécessairement voir cela à très court terme. Les démocrates ont d’or et déjà annoncé qu’ils chercheront davantage à collaborer avec la Maison Blanche, afin de sortir le pays du bourbier de façon plus efficace. La question de la destitution du président (empeachement) ne sera pas sur la table. On peut tout de même penser à un retrait progressif de l’Iraq, mais vraiment pas pour demain.
Il est évident pour l’administration Bush qu’elle devra se départir de ses attitudes impérialistes les plus visibles, dans un contexte exigeant justement le contraire. Comment rendre un discours cohérent de sa part, après six ans de défiance envers tous ses adversaires, alors que les électeurs viennent de désavouer lourdement le néo-conservatisme? La poursuite des politiques suivant la logique de la « guerre contre le terrorisme » et « l’Axe du mal », avec en prime la montée des périls en Iran, au Liban, dans le Caucase et les pantalonnades de la Corée du Nord a demandé un investissement tel qu’on ne peut régler ces problématiques de façon cavalière.
D’une part, l’Irak est dans un état larvé de guerre civil (encouragé par les politiques de division ethniques et religieuses des Occupants et le clivage résistants vs collaborateurs). La plupart des Démocrates ne voient pas la solution dans un retrait unilatéral des troupes américaine et alliées, en laissant aller la lutte entre les factions et la chute probable du gouvernement, sans aucune forme d’intervention. Il faut admettre que la population n’a pas majoritairement demandé cette solution par son vote, elle a demandé une solution au bourbier, mais pas le repli dans le désordre. La psyché populaire n’a pas oublié le retrait précipité du Vietnam et ses boat-peoples.
D’autre part, la politique étrangère menée par Bush a rompu avec ses prédécesseurs par le néo-conservatisme, mais sa succession devra trouver une solution entre le bellicisme issu de cette vision du monde et le retour à la vision à laquelle nous étions habitués (sous Bush père et Clinton), soit le néolibéralisme multilatéral, qui privilégie le libre-marché et la création de richesse (air connu) pour instaurer la « démocratie ».
À court terme, nous ne devrions pas voir un changement brutal, mais plutôt progressif, l’estompement graduel des politiques néo-conservatrices des idéologues de l’équipe Bush. Six ans de gâchis ne peuvent disparaître aussi rapidement que nous le souhaitons. Et Bush voudra sauver la face en maintenant au moins l’apparence d’une certaine continuité.
Un virage à gauche? Non, juste un peu moins à droite…
Va-t-on voir une amélioration de la situation politique et sociale aux États-Unis, pour les milliers de travailleurs précaires, les mères monoparentales, les immigrants de tous les statuts, les minorités, etc.? Rien n’est moins certain. Il reste deux ans au mandat du président Bush, le président situé le plus à droite depuis des générations. Celui-ci peut court-circuiter tout le processus législatif, en dépit de la double majorité démocrate au Congrès, par son droit de veto prévu dans la constitution. Étant donné son caractère brouillon, on ne pourra être surpris d’une attitude belliqueuse de sa part. Aussi, on ne peut être certain du caractère progressiste de la représentation. Le Parti démocrate s’est assuré, pour sa victoire, de présenter bon nombre de candidat aux convictions les plus modérées (incluant des fondamentalistes chrétiens). C’est ainsi que l’expression de Noam Chomsky pour qualifier les partis américains, le « parti unique bicéphale » prend tout son sens.
La victoire du Parti démocrate est tributaire de la présence de candidats fortement modérés. Certes, la présence de la nouvelle présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, une personnalité nettement de gauche pour son parti (pour le droit à l’avortement et les droits des homosexuels notamment), a permis de ranimer l’optimisme et l’espoir chez les observateurs progressistes, mais elle cache le conservatisme économique de la grande majorité des représentants, quand il n’est pas également marqué au plan social. Des congressistes comme Tammy Duckworth (Illinois), Tim Mahoney (Floride), les nouveaux sénateurs Jim Webb (Virginie) et Bob Casey (Pennsylvanie) sont toutes des personnalités très modérées, issues dans certains cas du Parti républicain.
Le parti Démocrate doit également sa victoire à l’effondrement de la coalition républicaine marquée par le conservatisme religieux, qui a mené les politiques du pays depuis l’avènement des majorités républicaines il y a 12 ans. Les nombreux scandales à caractère sexuel et de corruption de la dernière année, touchant des personnalités proche du pouvoir, ont éloigné des urnes les voix fondamentalistes nécessaire à l’administration Bush. En fait, pour bon nombres de candidats, il suffisait de préciser qu’ils n’étaient pas eux-mêmes des fondamentalistes, en fait, moins à droite que leur adversaire…
Plusieurs républicains ont sauvé leur peau en prenant toute la distance qui était possible avec Bush et son gouvernement. Une manœuvre que le système présidentiel permet et qui est serait impensable dans le système politique canadien.
En somme, c’est l’invasion de l’Iraq, que Bush et les néoconservateurs voyaient comme leur plus grande réussite, qui a provoqué la marée bleue des démocrates. La victoire sénatoriale cruciale en Virginie, la plus serrée et celle qui a finalement réduit le contingent républicain à 49 contre toute attente, a été emportée par un ancien républicain qui se promenait d’une assemblée publique à l’autre en brandissant une paire de bottes appartenant à son fils, un militaire basé en Iraq. Tout un symbole!
PS: merci à Benoît Renaud pour sa contribution à ce texte.